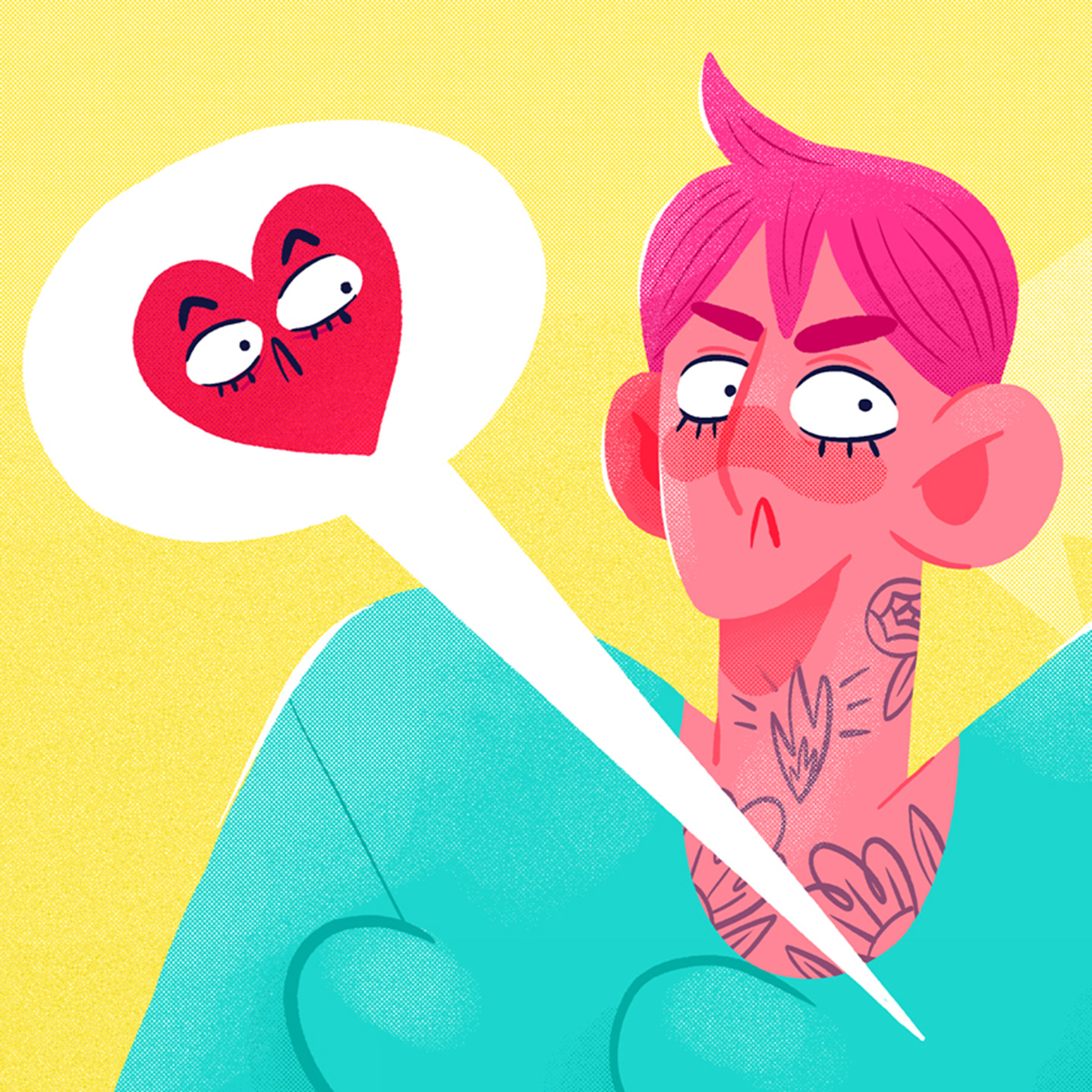Nous sommes maltraité.e.s
Il y a quelques jours, la sage-femme Anna Roy a lancé un mouvement - #jesuismaltraitante #jesuismaltraitant - pour dénoncer les violences faites aux parents lors de l’accouchement par le personnel soignant. Elle a ainsi appelé les soignants, ainsi que les parents, à témoigner. Voici mon témoignage.
Il y a 6 ans, j’ai accouché de mon premier enfant. Si je m’étais préparée autant que j’ai pu à cet événement, avec des cours de préparation et des lectures, à aucun moment je n’aurais pu imaginer ce qui allait se dérouler par la suite.
Nous sommes le lundi 29 septembre 2014. Vers 9h du matin, je commence à sentir des contractions. Ayant déjà dépassé le terme depuis une petite semaine, je les accueille avec une grande joie et une grande excitation. Je préviens Simon, qui rentre dans la seconde à la maison, excité comme une puce lui aussi. Les heures passent. Les contractions se rapprochent et s’intensifient. Seulement quelques minutes les séparent maintenant les unes des autres. Il doit être 13h. On part pour la maternité.
Arrivés là-bas, on nous prend en charge. On me pose un monitoring, on m’ausculte. Les contractions sont bien là, rapprochées, mais je ne suis pas dilatée. L’angoisse d’un faux travail plane alors au-dessus de nous. « Non, pas encore. » On attend. Les minutes, puis les heures défilent. Ça n’avance pas. La sage-femme, désabusée, me propose de rentrer chez moi. Je pleure. « Non, je ne veux pas, j’ai trop mal. » Elle voit ma détresse, ma douleur. Alors je reste. On m’injecte un dérivé de morphine. Je m’endors. Au réveil, on m’ausculte de nouveau. Ça n’a quasiment pas bougé. On nous conseille d’aller marcher. Alors on marche. Une randonnée étrange dans les couloirs sombres de l’hôpital. Il n’y a pas de bruits. On erre dans ce bâtiment abandonné, livrés à nous-mêmes.
Nous sommes le lundi 29 septembre 2014. Vers 9h du matin, je commence à sentir des contractions. Ayant déjà dépassé le terme depuis une petite semaine, je les accueille avec une grande joie et une grande excitation. Je préviens Simon, qui rentre dans la seconde à la maison, excité comme une puce lui aussi. Les heures passent. Les contractions se rapprochent et s’intensifient. Seulement quelques minutes les séparent maintenant les unes des autres. Il doit être 13h. On part pour la maternité.
Arrivés là-bas, on nous prend en charge. On me pose un monitoring, on m’ausculte. Les contractions sont bien là, rapprochées, mais je ne suis pas dilatée. L’angoisse d’un faux travail plane alors au-dessus de nous. « Non, pas encore. » On attend. Les minutes, puis les heures défilent. Ça n’avance pas. La sage-femme, désabusée, me propose de rentrer chez moi. Je pleure. « Non, je ne veux pas, j’ai trop mal. » Elle voit ma détresse, ma douleur. Alors je reste. On m’injecte un dérivé de morphine. Je m’endors. Au réveil, on m’ausculte de nouveau. Ça n’a quasiment pas bougé. On nous conseille d’aller marcher. Alors on marche. Une randonnée étrange dans les couloirs sombres de l’hôpital. Il n’y a pas de bruits. On erre dans ce bâtiment abandonné, livrés à nous-mêmes.
Les marches se succèdent. Les bains et les tours de ballon aussi. J’essaye de rester le plus active possible, malgré la fatigue, la douleur et le désespoir. On est mardi 30 septembre, c’est le matin. Une infirmière m’ausculte : « Vous êtes à 2 cm ! C’est un vrai travail ». Victoire ! On quitte la salle et on nous conduit dans une petite chambre. Je mange pour la première fois depuis presque 24 heures. J’ai l’impression de revivre. Les soignants me conseille de rester active, pour faciliter l’avancée du travail. On continue donc à marcher. Le jour étant levé, on en profite pour faire des tours sur le parking. Ça nous change un peu des couloirs. J’enchaîne les douches chaudes, les fesses vissées sur mon ballon. À cet instant, je ressemble plus à un Culbuto qu’à une femme sur le point d’accoucher.
La journée passe. Régulièrement, une soignante vient vérifier l’avancée du travail. Toujours 2 cm. Rien ne bouge. Je désespère. Le soir venu, une nouvelle infirmière entre dans la chambre. À peine a-t-elle soulevé le drap qui recouvre mes jambes que je pleure déjà. « Dites-moi que je ne suis plus à 2 cm. Je vous en prie. » Elle mets ses doigts. Elle me regarde et ses yeux ne peuvent pas mentir. Elle les baisse. Elle souffle un bon coup. « Aller, on va dire que vous êtes à 2,5 cm ! On va vous poser la péridurale. » Enfin ! Je vais avoir un peu de répit.
La journée passe. Régulièrement, une soignante vient vérifier l’avancée du travail. Toujours 2 cm. Rien ne bouge. Je désespère. Le soir venu, une nouvelle infirmière entre dans la chambre. À peine a-t-elle soulevé le drap qui recouvre mes jambes que je pleure déjà. « Dites-moi que je ne suis plus à 2 cm. Je vous en prie. » Elle mets ses doigts. Elle me regarde et ses yeux ne peuvent pas mentir. Elle les baisse. Elle souffle un bon coup. « Aller, on va dire que vous êtes à 2,5 cm ! On va vous poser la péridurale. » Enfin ! Je vais avoir un peu de répit.
On nous conduit dans une salle de travail. Le personnel s’active autour de nous. J’angoisse un peu, mais Simon est là. L’anesthésiste fait son entrer. Il porte des lunettes de soleil. Incompréhension. Pas un bonjour, rien. Il jette un œil à mes jambes gonflée. « Eh bien ! Elle fait beaucoup de rétention d’eau celle-là ! ». « Celle-là » ? La sage-femme lui répond : « En même temps, cette jeune femme est là depuis 36 heures, on peut peut-être laisser ses œdèmes de coté ? ». Il ne répond pas. Il se tourne vers Simon : « Monsieur, vous devez sortir. » Quoi ? Non, c’est pas possible. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester pendant la pose de la péridurale. » Non ! Simon sort. La panique m’étreint. J’ai du mal à respirer. La sage-femme le voit. Elle prends une voix douce et se colle à moi. « J’ai peur. — Vous voulez qu’on parle ? — Oui. — Alors, racontez-moi en détail comment est la chambre de votre bébé. » Je lui décris avec précision l’emplacement de chaque meuble, la couleur de chaque peluche, de chaque bibelot que contient sa chambre. Pendant ce temps, l’anesthésiste me pique une première fois. J’ai mal. « Raté ! Il faut que je recommence. » Une infirmière lui conseille alors de retirer ses lunettes de soleil. Il s’exécute, non sans une certaine réticence. Il me repique. Je tremble comme une feuille. « Cette fois, c’est bon ! » Je suis soulagée. Simon rentre dans la chambre. Il s’installe à mes côtés. On nous explique le fonctionnement de la péridurale. On nous laisse seuls, de nouveau.
À ce moment-là, je me souviens d’une sensation très claire. La soif. Une soif immense. Ça faisait des heures que je n’avais rien bu. Simon me vide la moitié du brumisateur dans la bouche. Encore ! La sage-femme entre dans la chambre pour m’ausculter. Je suis à 5 cm. Ça avance, mais peu. Elle me rassure. Je lui demande si je peux avoir un verre d’eau. « Normalement, je ne peux pas vous en donner, pas avec la péridurale. » Je la supplie. « D’accord ! Vous buvez à petites gorgées, mais à la moindre nausée, vous arrêtez ! ». Merci...
À ce moment-là, je me souviens d’une sensation très claire. La soif. Une soif immense. Ça faisait des heures que je n’avais rien bu. Simon me vide la moitié du brumisateur dans la bouche. Encore ! La sage-femme entre dans la chambre pour m’ausculter. Je suis à 5 cm. Ça avance, mais peu. Elle me rassure. Je lui demande si je peux avoir un verre d’eau. « Normalement, je ne peux pas vous en donner, pas avec la péridurale. » Je la supplie. « D’accord ! Vous buvez à petites gorgées, mais à la moindre nausée, vous arrêtez ! ». Merci...
La nuit avance. Mon travail, faiblement. Dans le silence de la nuit, j’entends par intermittence des cris de femmes qui accouchent, elles. « Tout le monde accouche, sauf moi. » La sage-femme vient faire un ultime contrôle avant la fin de sa garde. Sept centimètres. Je pleure. Elle est désolée. « J’aurais tellement aimé que vous m’accouchiez », je lui dis entre deux sanglots. Elle aussi. « Allez ! Encore un peu de courage, vous y êtes presque. »
Le soleil se lève. On est mercredi. Ça fait plus de 40 heures que je suis là. Je suis à bout. Une nouvelle sage-femme entre. Elle m’ausculte. « Vous êtes à 10 centimètres ! » Quoi ? Alors ça y est ? Je vais enfin avoir mon bébé ? Avec Simon, on se regarde, ivres d’excitation et de fatigue. J’ai l’impression d’être portée par une énergie nouvelle. Tout le monde s’active autour de nous. Je vois une sage-femme arriver avec un lit pour le bébé. La gynécologue entre. À son tour de m’ausculter. Son visage se crispe. Je m’inquiète. « Le bébé est encore très haut, il n’est pas dans votre bassin. » Qu’est-ce que ça veut dire ? Elle me fait une échographie. « La tête de votre bébé est en arrière, il n’arrive pas à descendre. Je vais essayer de la lui baisser. » Elle enfonce sa main. J’ai mal. « Voilà ! On va attendre une petite heure et on verra si c’est mieux. » Simon et moi sommes hébétés. Dix minutes après, la gynécologue revient : « J’ai parlé au médecin, on ne va finalement pas attendre. On vous césarise en urgence. » Mon sang se glace. Une césarienne ? Après 46 heures de travail ? Après tout ce que j’ai subi ? Je m’effondre.
Il est 11h. À partir de là, tout s’accélère. On emmène Simon pour le préparer. J’entre seule dans la salle d’opération. Tout semble aller si vite, je ne comprends plus rien. On m’écarte les bras et on me les attache. Une infirmière m’explique ce qui va se passer. On dresse un drap entre le haut et le reste de mon corps. Simon entre à son tour. Il s’assoie à côté de ma tête. Je pleure. Je tremble. Je suis épuisée. On m’ouvre. J’attends. J’attends d’entendre mon bébé crier. J’angoisse. Et puis d’un coup, un cri. Enfin. Je pleure de nouveau.
Le soleil se lève. On est mercredi. Ça fait plus de 40 heures que je suis là. Je suis à bout. Une nouvelle sage-femme entre. Elle m’ausculte. « Vous êtes à 10 centimètres ! » Quoi ? Alors ça y est ? Je vais enfin avoir mon bébé ? Avec Simon, on se regarde, ivres d’excitation et de fatigue. J’ai l’impression d’être portée par une énergie nouvelle. Tout le monde s’active autour de nous. Je vois une sage-femme arriver avec un lit pour le bébé. La gynécologue entre. À son tour de m’ausculter. Son visage se crispe. Je m’inquiète. « Le bébé est encore très haut, il n’est pas dans votre bassin. » Qu’est-ce que ça veut dire ? Elle me fait une échographie. « La tête de votre bébé est en arrière, il n’arrive pas à descendre. Je vais essayer de la lui baisser. » Elle enfonce sa main. J’ai mal. « Voilà ! On va attendre une petite heure et on verra si c’est mieux. » Simon et moi sommes hébétés. Dix minutes après, la gynécologue revient : « J’ai parlé au médecin, on ne va finalement pas attendre. On vous césarise en urgence. » Mon sang se glace. Une césarienne ? Après 46 heures de travail ? Après tout ce que j’ai subi ? Je m’effondre.
Il est 11h. À partir de là, tout s’accélère. On emmène Simon pour le préparer. J’entre seule dans la salle d’opération. Tout semble aller si vite, je ne comprends plus rien. On m’écarte les bras et on me les attache. Une infirmière m’explique ce qui va se passer. On dresse un drap entre le haut et le reste de mon corps. Simon entre à son tour. Il s’assoie à côté de ma tête. Je pleure. Je tremble. Je suis épuisée. On m’ouvre. J’attends. J’attends d’entendre mon bébé crier. J’angoisse. Et puis d’un coup, un cri. Enfin. Je pleure de nouveau.
La sage-femme m’amène le bébé. Je le regarde, les yeux plein de larmes. Je me tourne vers Simon : « C’est Nino ! ». Je le dévore des yeux, à défaut de pouvoir le prendre dans mes bras. Puis, la sage-femme part, avec Simon et Nino. Moi, je reste seule dans la salle d’opération. Ils me referment. Je sombre.
Je me réveille dans une pièce qui me paraît démesurément grande. Il fait sombre. Je suis seule. Une infirmière vient enfin me voir. « Vous voulez qu’on vous amène votre bébé ? — Oui ! » Nino est dans un petit berceau transparent. Je le regarde. Je demande à ce qu’on le mette dans les bras, car avec l’opération, impossible de le prendre seule. Je lui donne le sein et le garde quelques instants au chaud contre moi.
Soudain, une douleur foudroyante me transperce. Mon dos. La douleur est telle que je peine à respirer. Je hurle. Un infirmier arrive et me donne des anti-douleurs. Je me calme. Les heures passent. Nino et moi sommes seuls dans cette grande pièce. Par moment, j’ai peur qu’on nous ait oublié et que jamais nous ne sortirons d’ici. Je demande à un infirmier quand je pourrai aller dans ma chambre rejoindre mon mari. « Il faut que l’infirmière en chef signe un papier pour que vous puissiez monter. — Je comprends. Et ce sera quand ? — Quand elle aura le temps. — Ah. Est-ce que je peux avoir un verre d’eau en attendant ? — Quand vous serez dans votre chambre. — Ah. » J’attends, donc. De toute façon, je ne suis plus bonne qu’à ça.
Je me réveille dans une pièce qui me paraît démesurément grande. Il fait sombre. Je suis seule. Une infirmière vient enfin me voir. « Vous voulez qu’on vous amène votre bébé ? — Oui ! » Nino est dans un petit berceau transparent. Je le regarde. Je demande à ce qu’on le mette dans les bras, car avec l’opération, impossible de le prendre seule. Je lui donne le sein et le garde quelques instants au chaud contre moi.
Soudain, une douleur foudroyante me transperce. Mon dos. La douleur est telle que je peine à respirer. Je hurle. Un infirmier arrive et me donne des anti-douleurs. Je me calme. Les heures passent. Nino et moi sommes seuls dans cette grande pièce. Par moment, j’ai peur qu’on nous ait oublié et que jamais nous ne sortirons d’ici. Je demande à un infirmier quand je pourrai aller dans ma chambre rejoindre mon mari. « Il faut que l’infirmière en chef signe un papier pour que vous puissiez monter. — Je comprends. Et ce sera quand ? — Quand elle aura le temps. — Ah. Est-ce que je peux avoir un verre d’eau en attendant ? — Quand vous serez dans votre chambre. — Ah. » J’attends, donc. De toute façon, je ne suis plus bonne qu’à ça.
Vers 17h, l’infirmière en chef arrive enfin. Je reprends espoir. Elle me regarde. « Bah alors, c’est vous qui avez crié tout à l’heure ? — Oui, j’ai eu subitement mal dans tout le dos. — Bah faut pas paniquer comme ça ! Vous vous rendez compte que vous nous avez fait peur. Il faut savoir se maîtriser un peu et garder la tête froide ! — ... Pardon... »
Je monte enfin dans ma chambre. Je retrouve Simon.
Sur le moment, je n’ai pas mesuré la violence des mots de cette femme. Après 46 heures de travail et une césarienne d’urgence, je n’avais pas le droit à sa compassion. Juste des reproches. Et le pire dans tout ça, c’est que je me suis excusée.
Perdue dans cette grande pièce, je n’ai jamais autant ressenti le poids de la solitude.
Le lendemain matin, un infirmier m’explique que ce que j’ai vécu n’est pas normal. Jamais on aurait dû laisser une femme en travail si longtemps. Seulement, ils étaient totalement débordés. Nous étions nombreuses et eux, non. J’ai donc écopé.
Je monte enfin dans ma chambre. Je retrouve Simon.
Sur le moment, je n’ai pas mesuré la violence des mots de cette femme. Après 46 heures de travail et une césarienne d’urgence, je n’avais pas le droit à sa compassion. Juste des reproches. Et le pire dans tout ça, c’est que je me suis excusée.
Perdue dans cette grande pièce, je n’ai jamais autant ressenti le poids de la solitude.
Le lendemain matin, un infirmier m’explique que ce que j’ai vécu n’est pas normal. Jamais on aurait dû laisser une femme en travail si longtemps. Seulement, ils étaient totalement débordés. Nous étions nombreuses et eux, non. J’ai donc écopé.